Calcul du risque de condensation
Contexte : L'humidité dans les parois.
La vapeur d'eau est toujours présente dans l'air. En hiver, l'air intérieur d'un bâtiment est généralement plus chaud et plus humide que l'air extérieur. Cette différence de pression de vapeur pousse l'humidité à travers les murs, du dedans vers le dehors. Si la température à l'intérieur de la paroi chute sous un certain seuil, appelé le point de roséeTempérature à laquelle l'air doit être refroidi, à pression constante, pour devenir saturé en vapeur d'eau et commencer à former de la condensation., la vapeur d'eau se condense et redevient liquide. Cette condensation interne peut dégrader les matériaux, réduire l'efficacité de l'isolant et provoquer des moisissures. Cet exercice vous guidera dans l'analyse de ce risque à l'aide de la méthode du diagramme de Glaser.
Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à modéliser les transferts de chaleur et de vapeur à travers un mur composite, à calculer les profils de température et de pression, et à utiliser le diagramme de Glaser pour diagnostiquer le risque de condensation interstitielle, une compétence fondamentale en thermique du bâtiment.
Objectifs Pédagogiques
- Comprendre le phénomène de migration de la vapeur d'eau dans les parois.
- Calculer les pressions de vapeur et les pressions de vapeur saturante.
- Établir le profil de température à travers une paroi multicouche.
- Construire et interpréter un diagramme de Glaser pour évaluer le risque de condensation.
Données de l'étude
Conditions Hygrothermiques
| Caractéristique | Intérieur (i) | Extérieur (e) |
|---|---|---|
| Température (\(\theta\)) | 20 °C | -5 °C |
| Humidité Relative (HR) | 65 % | 80 % |
Composition de la Paroi (de l'intérieur vers l'extérieur)
| Matériau | Épaisseur (\(e\)) | Conductivité thermique (\(\lambda\)) | Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (\(\mu\)) |
|---|---|---|---|
| Plâtre | 0.015 m | 0.5 W/(m\(\cdot\)K) | 10 |
| Brique pleine | 0.20 m | 0.7 W/(m\(\cdot\)K) | 15 |
| Isolant (Laine de roche) | 0.12 m | 0.04 W/(m\(\cdot\)K) | 1.2 |
| Enduit extérieur | 0.02 m | 0.8 W/(m\(\cdot\)K) | 25 |
Questions à traiter
- Calculer la pression de vapeur saturante à l'intérieur (\(P_{\text{sat,i}}\)) et à l'extérieur (\(P_{\text{sat,e}}\)).
- En déduire la pression de vapeur réelle à l'intérieur (\(P_{\text{v,i}}\)) et à l'extérieur (\(P_{\text{v,e}}\)).
- Calculer les résistances thermiques de chaque couche et déterminer le profil de température aux interfaces du mur.
- À partir du profil de température, calculer la pression de vapeur saturante à chaque interface de la paroi.
- Tracer le diagramme de Glaser en représentant la pression de vapeur (\(P_{\text{v}}\)) et la pression de vapeur saturante (\(P_{\text{sat}}\)) à travers la paroi.
- Analyser le diagramme : y a-t-il un risque de condensation ? Si oui, dans quelle zone ?
Les bases de la thermique et de l'hygrométrie
Pour résoudre cet exercice, plusieurs concepts clés sont nécessaires.
1. Pression de Vapeur Saturante (\(P_{\text{sat}}\))
C'est la pression maximale de vapeur d'eau que l'air peut contenir à une température donnée. Au-delà de cette valeur, la vapeur se condense. On peut la calculer avec la formule de Magnus (simplifiée) :
\[ P_{\text{sat}}(\theta) = 611.2 \cdot \exp\left(\frac{17.62 \cdot \theta}{243.12 + \theta}\right) \]
Où \(\theta\) est la température en \(\text{°C}\) et \(P_{\text{sat}}\) est en \(\text{Pascals (Pa)}\).
2. Pression de Vapeur (\(P_{\text{v}}\))
C'est la pression réelle exercée par la vapeur d'eau dans l'air. Elle est liée à l'humidité relative (HR) par la relation :
\[ P_{\text{v}} = P_{\text{sat}} \cdot \frac{\text{HR}}{100} \]
3. Résistance à la Diffusion de Vapeur (\(S_{\text{d}}\))
Aussi appelée "épaisseur d'air équivalente", elle caractérise la difficulté pour la vapeur d'eau de traverser un matériau. Elle se calcule par :
\[ S_{\text{d}} = \mu \cdot e \]
Où \(e\) est l'épaisseur du matériau (en \(\text{m}\)) et \(\mu\) est son facteur de résistance à la diffusion (sans dimension).
Correction : Calcul du risque de condensation
Question 1 : Calculer la pression de vapeur saturante (\(P_{\text{sat,i}}\)) et (\(P_{\text{sat,e}}\))
Principe (le concept physique)
L'air qui nous entoure contient de la vapeur d'eau invisible. Cependant, l'air ne peut en contenir qu'une quantité maximale. Cette limite dépend directement de sa température : plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. La "pression de vapeur saturante" est la mesure de cette limite maximale. Si on dépasse cette limite, l'excès de vapeur d'eau est forcé de redevenir liquide : c'est la condensation.
Mini-Cours (approfondissement théorique)
La relation entre la température et la pression de vapeur saturante est décrite par la relation de Clausius-Clapeyron, une loi fondamentale de la thermodynamique. Cependant, pour des applications pratiques en thermique du bâtiment, on utilise des formules empiriques très précises, comme la formule de Magnus, qui est une excellente approximation de ce phénomène physique complexe. Elle montre que la relation n'est pas linéaire mais exponentielle : une petite augmentation de température entraîne une forte augmentation de la capacité de l'air à stocker de l'humidité.
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
L'erreur la plus commune dans les calculs hygrothermiques est de confondre la pression de vapeur saturante (\(P_{\text{sat}}\)), qui est une limite théorique dépendant uniquement de la température, et la pression de vapeur réelle (\(P_{\text{v}}\)), qui dépend aussi de l'humidité relative. Prenez toujours le temps de bien identifier laquelle des deux vous devez calculer. Pour cette première question, on ne s'intéresse qu'à la limite maximale possible.
Normes (la référence réglementaire)
Bien que la formule de Magnus soit une loi physique, son utilisation et les méthodologies d'analyse de la condensation dans les parois sont encadrées par des normes, notamment la norme internationale ISO 13788 "Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments - Température superficielle intérieure permettant d'éviter l'humidité superficielle critique et condensation interstitielle".
Formule(s) (l'outil mathématique)
Formule de Magnus
Hypothèses (le cadre du calcul)
Pour ce calcul, nous posons les hypothèses suivantes :
- L'air est considéré comme un mélange de gaz parfaits.
- La pression atmosphérique est standard (environ 101325 Pa).
- La formule de Magnus est suffisamment précise pour la plage de températures de notre étude.
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Température intérieure | \(\theta_{\text{i}}\) | 20 | °C |
| Température extérieure | \(\theta_{\text{e}}\) | -5 | °C |
Astuces (Pour aller plus vite)
Pour vérifier rapidement vos calculs, il existe de nombreux calculateurs de point de rosée ou de pression de vapeur saturante en ligne. C'est un excellent moyen de s'assurer que vous n'avez pas fait d'erreur de saisie sur votre calculatrice. De plus, retenez l'ordre de grandeur : à 20°C, la \(P_{\text{sat}}\) est d'environ 2300-2400 Pa.
Schéma (Avant les calculs)
On visualise simplement les deux ambiances thermiques que nous allons étudier.
Ambiances Intérieure et Extérieure
Calcul(s) (l'application numérique)
Pression de vapeur saturante à l'intérieur (\(\theta_{\text{i}} = 20 \text{ °C}\))
Pression de vapeur saturante à l'extérieur (\(\theta_{\text{e}} = -5 \text{ °C}\))
Schéma (Après les calculs)
La différence de capacité de l'air à contenir de l'humidité est frappante.
Comparaison des Pressions de Vapeur Saturante
Réflexions (l'interprétation du résultat)
Le résultat est sans appel : l'air intérieur, à 20°C, peut contenir plus de 5 fois plus de vapeur d'eau (\(2339 / 422 \approx 5.5\)) que l'air extérieur à -5°C avant d'atteindre le point de condensation. C'est cette énorme différence de potentiel qui est au cœur du problème de la migration de vapeur en hiver.
Points de vigilance (les erreurs à éviter)
Trois erreurs classiques à éviter :
- Erreur de signe : Ne pas oublier le signe "-" pour la température extérieure dans le numérateur et le dénominateur de la fraction.
- Calculatrice : Assurez-vous d'utiliser correctement la fonction exponentielle (\(e^x\) ou \(\exp\)) de votre calculatrice.
- Unités : La formule donne un résultat en Pascals (Pa), l'unité de base du système international. Ne pas confondre avec les hPa ou kPa.
Points à retenir (pour maîtriser la question)
Pour cette question, retenez ces trois points essentiels :
- La pression de vapeur saturante (\(P_{\text{sat}}\)) est la limite maximale d'humidité dans l'air.
- Elle ne dépend que de la température.
- Elle augmente de manière exponentielle avec la température.
Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)
La formule de Magnus, bien que très utilisée, n'est qu'une des nombreuses approximations existantes. Une autre, encore plus précise et utilisée en météorologie, est la formule de Goff-Gratch. Cependant, pour le bâtiment, la précision de la formule de Magnus est largement suffisante et bien plus simple à calculer !
FAQ (pour lever les doutes)
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour vérifier la compréhension)
Pour vous entraîner, calculez la pression de vapeur saturante pour une température de 15 °C.
Question 2 : Calculer la pression de vapeur réelle (\(P_{\text{v,i}}\)) et (\(P_{\text{v,e}}\))
Principe (le concept physique)
L'air est rarement complètement saturé en humidité. L'Humidité Relative (HR) nous indique justement à quel point on est proche de la saturation. Une HR de 65% signifie que l'air contient 65% de la quantité maximale de vapeur d'eau qu'il pourrait contenir à cette température. La pression de vapeur réelle est donc simplement ce pourcentage de la pression de vapeur saturante.
Mini-Cours (approfondissement théorique)
La pression totale de l'air que nous respirons (environ 101325 Pa) est la somme des pressions partielles de tous les gaz qui le composent : principalement l'azote (\(N_2\)), l'oxygène (\(O_2\)), et dans une moindre mesure, la vapeur d'eau (\(H_2O\)). La pression de vapeur réelle (\(P_{\text{v}}\)) est la pression partielle de la vapeur d'eau. C'est la différence de cette pression partielle entre deux ambiances qui constitue le "moteur" de la diffusion de la vapeur.
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
Attention à ne pas comparer directement les pourcentages d'humidité relative ! 80% d'humidité à -5°C représente beaucoup moins d'eau dans l'air que 65% à 20°C. Pour comparer des quantités d'humidité, il faut toujours passer par le calcul des pressions de vapeur réelles (ou des humidités absolues en g/m³).
Normes (la référence réglementaire)
Les conditions de confort hygrothermique pour les occupants sont définies dans des normes comme la ISO 7730. Ces normes recommandent des plages d'humidité relative (typiquement entre 30% et 70%) pour assurer le bien-être et la santé, ce qui justifie les valeurs prises dans l'énoncé de l'exercice.
Formule(s) (l'outil mathématique)
Formule de la Pression de Vapeur
Hypothèses (le cadre du calcul)
Nous supposons que les valeurs de température et d'humidité relative données sont stables et représentatives des conditions moyennes pour la période étudiée.
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Pression de saturation intérieure | \(P_{\text{sat,i}}\) | 2339 | Pa |
| Humidité relative intérieure | \(HR_{\text{i}}\) | 65 | % |
| Pression de saturation extérieure | \(P_{\text{sat,e}}\) | 422 | Pa |
| Humidité relative extérieure | \(HR_{\text{e}}\) | 80 | % |
Astuces (Pour aller plus vite)
Le calcul est une simple multiplication. Pour aller vite, pensez "65% de 2339" et "80% de 422". Cela vous permet de vérifier mentalement l'ordre de grandeur de votre résultat avant même de finir le calcul précis.
Schéma (Avant les calculs)
On visualise les deux ambiances avec toutes leurs caractéristiques hygrothermiques.
Ambiances Hygrothermiques
Calcul(s) (l'application numérique)
Pression de vapeur réelle à l'intérieur
Pression de vapeur réelle à l'extérieur
Schéma (Après les calculs)
Ce diagramme compare la pression réelle (\(P_v\)) à la pression de saturation (\(P_{sat}\)) pour chaque ambiance. On voit que dans les deux cas, on est bien en dessous de la limite de saturation.
Comparaison \(P_v\) et \(P_{sat}\)
Réflexions (l'interprétation du résultat)
Malgré une humidité relative plus faible (65% vs 80%), la pression de vapeur réelle à l'intérieur (1520 Pa) est bien plus élevée qu'à l'extérieur (338 Pa). C'est cette différence de pression, \(\Delta P_{\text{v}} = 1520 - 338 = 1182 \text{ Pa}\), qui est la force motrice du flux de vapeur à travers le mur.
Points de vigilance (les erreurs à éviter)
L'erreur principale est d'inverser les valeurs ou de se tromper de \(P_{\text{sat}}\) de référence. Assurez-vous bien d'associer l'humidité relative intérieure avec la pression de saturation intérieure, et de même pour l'extérieur.
Points à retenir (pour maîtriser la question)
Retenez ceci :
- \(P_{\text{v}}\) est la pression "réelle", \(P_{\text{sat}}\) est la pression "limite".
- \(P_{\text{v}}\) se calcule à partir de \(P_{\text{sat}}\) et de l'Humidité Relative (HR).
- C'est la différence de \(P_{\text{v}}\) qui crée le flux de vapeur, pas la différence de HR.
Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)
Les musées et les centres d'archives sont des lieux où le contrôle de l'humidité relative est crucial pour la conservation des œuvres. Ils utilisent des systèmes de CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) extrêmement sophistiqués pour maintenir une humidité stable (souvent autour de 50%) toute l'année, afin d'éviter la dégradation des matériaux organiques comme le papier, le bois ou la toile.
FAQ (pour lever les doutes)
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour vérifier la compréhension)
Si, à l'intérieur, la température est toujours de 20°C (\(P_{\text{sat,i}}=2339 \text{ Pa}\)) mais que l'humidité relative monte à 75%, quelle serait la nouvelle pression de vapeur réelle \(P_{\text{v,i}}\) ?
Question 3 : Calculer les résistances thermiques et le profil de température
Principe (le concept physique)
De la même manière que l'électricité rencontre une résistance en traversant un câble, la chaleur rencontre une résistance en traversant un matériau. Cette "résistance thermique" dépend de l'épaisseur du matériau et de sa capacité à conduire la chaleur (\(\lambda\)). Plus la résistance d'une couche est grande, plus la "chute de tension" (ici, la chute de température) sera importante à ses bornes.
Mini-Cours (approfondissement théorique)
Le transfert de chaleur à travers un mur est un phénomène de conduction en régime stationnaire. La loi de Fourier nous dit que le flux de chaleur (\(\phi\)) est proportionnel à la différence de température (\(\Delta\theta\)) et inversement proportionnel à la résistance thermique totale (\(R_{\text{th,total}}\)). \(\phi = \Delta\theta / R_{\text{th,total}}\). Ce flux est constant à travers toutes les couches du mur. Ainsi, pour chaque couche, on a \(\phi = \Delta\theta_{\text{couche}} / R_{\text{th,couche}}\). C'est cette proportionnalité qui nous permet de calculer la chute de température à chaque interface.
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
N'oubliez jamais les résistances superficielles ! La chaleur ne passe pas "instantanément" de l'air ambiant à la surface du mur. Il y a des phénomènes de convection et de rayonnement qui créent une résistance d'échange en surface. On les modélise par deux résistances forfaitaires, \(R_{\text{si}}\) (intérieur) et \(R_{\text{se}}\) (extérieur), qui sont indispensables pour un calcul correct.
Normes (la référence réglementaire)
Les valeurs des résistances superficielles d'échange (\(R_{\text{si}}\) et \(R_{\text{se}}\)) sont données par la norme ISO 6946. Elles dépendent de la direction du flux de chaleur (horizontal, ascendant, descendant) et de la ventilation de la surface. Pour un mur (flux horizontal), les valeurs conventionnelles sont \(R_{\text{si}} = 0.13 \text{ m²}\cdot\text{K/W}\) et \(R_{\text{se}} = 0.04 \text{ m²}\cdot\text{K/W}\).
Formule(s) (l'outil mathématique)
Résistance thermique d'une couche
Température à une interface
Hypothèses (le cadre du calcul)
Le calcul est réalisé en supposant :
- Un transfert de chaleur unidimensionnel (perpendiculaire au mur).
- Un régime stationnaire (les températures ne varient pas dans le temps).
- Les matériaux sont homogènes et leurs propriétés thermiques sont constantes.
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Température intérieure | \(\theta_i\) | 20 | °C |
| Température extérieure | \(\theta_e\) | -5 | °C |
| Épaisseur / Conductivité Plâtre | \(e_1 / \lambda_1\) | 0.015 / 0.5 | m / W/(m.K) |
| Épaisseur / Conductivité Brique | \(e_2 / \lambda_2\) | 0.20 / 0.7 | m / W/(m.K) |
| Épaisseur / Conductivité Isolant | \(e_3 / \lambda_3\) | 0.12 / 0.04 | m / W/(m.K) |
| Épaisseur / Conductivité Enduit | \(e_4 / \lambda_4\) | 0.02 / 0.8 | m / W/(m.K) |
| Résistance superficielle int. | \(R_{si}\) | 0.13 | m².K/W |
| Résistance superficielle ext. | \(R_{se}\) | 0.04 | m².K/W |
Schéma (Avant les calculs)
On représente la paroi avec les températures connues aux extrémités et les températures inconnues aux interfaces que l'on cherche à déterminer.
Inconnues du Profil de Température
Calcul(s) (l'application numérique)
Étape 1 : Calcul des résistances thermiques
Résistance superficielle intérieure
Résistance thermique du plâtre
Résistance thermique de la brique
Résistance thermique de l'isolant
Résistance thermique de l'enduit
Résistance superficielle extérieure
Résistance thermique totale de la paroi
Étape 2 : Calcul des températures aux interfaces
Différence de température totale
Température interface 1 (Plâtre/Brique)
Température interface 2 (Brique/Isolant)
Température interface 3 (Isolant/Enduit)
Schéma (Après les calculs)
On peut visualiser la chute de température à travers le mur. La pente est d'autant plus forte que la résistance thermique est grande.
Profil de Température dans la Paroi
Réflexions (l'interprétation du résultat)
Le profil de température montre clairement le rôle de chaque couche. La température chute très peu dans le plâtre, la brique et l'enduit (matériaux conducteurs), mais elle plonge de +16.8°C à -4.5°C à travers l'isolant. Cela démontre que l'isolant assure la quasi-totalité de la performance thermique du mur, ce qui est le but recherché.
Points de vigilance (les erreurs à éviter)
L'erreur la plus fréquente est d'oublier les résistances superficielles \(R_{\text{si}}\) et \(R_{\text{se}}\) dans le calcul de la résistance totale \(R_{\text{th,total}}\). Sans elles, le calcul des températures de surface et d'interface sera incorrect.
Points à retenir (pour maîtriser la question)
À retenir :
- La résistance thermique \(R_{\text{th}}\) est le rapport de l'épaisseur sur la conductivité thermique.
- La résistance totale d'un mur est la somme des résistances de chaque couche, SANS OUBLIER les résistances superficielles.
- La température chute proportionnellement à la résistance thermique cumulée.
Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)
Le concept de résistance thermique est une analogie directe de la loi d'Ohm en électricité (\(U=R \cdot I\)). La différence de potentiel (tension U) est analogue à la différence de température (\(\Delta\theta\)), l'intensité (I) est analogue au flux de chaleur (\(\phi\)), et la résistance électrique (R) est analogue à la résistance thermique (\(R_{\text{th}}\)). Cette analogie est très puissante pour comprendre les transferts thermiques.
FAQ (pour lever les doutes)
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour vérifier la compréhension)
Si on doublait l'épaisseur de l'isolant (24 cm au lieu de 12), quelle serait approximativement la nouvelle température à l'interface Isolant/Enduit ? (Indice : recalculez \(R_{\text{isolant}}\) et \(R_{\text{total}}\)).
Question 4 : Calculer la pression de vapeur saturante aux interfaces
Principe (le concept physique)
Nous savons maintenant qu'à chaque point à l'intérieur du mur correspond une température précise. Et comme nous l'avons vu à la question 1, à chaque température correspond une pression de vapeur saturante maximale. Cette étape consiste simplement à appliquer la formule de Magnus aux températures que nous venons de calculer pour chaque interface.
Mini-Cours (approfondissement théorique)
En combinant les résultats des questions 1 et 3, on établit le "profil de saturation" à travers le mur. C'est une courbe qui représente la limite de condensation en chaque point de la paroi. Si, en un point quelconque, la pression de vapeur réelle venait à dépasser la valeur de cette courbe, de l'eau liquide apparaîtrait. Cette courbe est donc notre critère de sécurité, notre "ligne rouge" à ne pas franchir.
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
Cette question est une application directe. Il n'y a pas de nouveau concept, juste le besoin d'être rigoureux et de bien reprendre les températures calculées à la question 3, sans erreur d'arrondi si possible. C'est une étape charnière qui prépare l'analyse finale du diagramme de Glaser.
Formule(s) (l'outil mathématique)
Formule de Magnus
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Température interface 1 | \(\theta_1\) | 18.86 | °C |
| Température interface 2 | \(\theta_2\) | 16.82 | °C |
| Température interface 3 | \(\theta_3\) | -4.54 | °C |
Schéma (Avant les calculs)
Le schéma représente la paroi et les points (interfaces) où la pression de vapeur saturante doit être déterminée, sur la base du profil de température.
Points de calcul de la Pression de Saturation
Calcul(s) (l'application numérique)
Pression de saturation à l'interface 1 (\(\theta_1 = 18.86\text{ °C}\))
Pression de saturation à l'interface 2 (\(\theta_2 = 16.82\text{ °C}\))
Pression de saturation à l'interface 3 (\(\theta_3 = -4.54\text{ °C}\))
Schéma (Après les calculs)
Ce graphique montre le profil de la pression de vapeur saturante. La courbe suit l'allure du profil de température : elle chute brutalement au niveau de l'isolant.
Profil de Pression de Vapeur Saturante
Réflexions (l'interprétation du résultat)
On observe que la pression de saturation chute drastiquement à travers l'isolant (de 1918 Pa à 432 Pa), suivant la chute de température. Cela signifie que la capacité de l'air à retenir l'humidité devient très faible dans la partie froide du mur, ce qui augmente le risque qu'une grande quantité de vapeur venant de l'intérieur s'y retrouve piégée et condense.
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour vérifier la compréhension)
Imaginons une paroi moins bien isolée où la température à l'interface isolant/enduit (\(\theta_3\)) serait de 0°C. Quelle serait la pression de saturation à ce point ?
Question 5 : Tracer le diagramme de Glaser
Principe (le concept physique)
Le diagramme de Glaser est un outil visuel puissant. Son principe est de superposer sur un même graphique la "réalité" (la pression de vapeur réelle, \(P_{\text{v}}\)) et la "limite à ne pas dépasser" (la pression de vapeur saturante, \(P_{\text{sat}}\)). Si à un endroit quelconque du mur la courbe de la réalité passe au-dessus de la courbe de la limite, alors il y a condensation. C'est une sorte de "carte du risque d'humidité" à l'intérieur de la paroi.
Mini-Cours (approfondissement théorique)
La méthode a été développée par l'ingénieur allemand Heinz Glaser. Son ingéniosité a été de ne pas utiliser l'épaisseur géométrique du mur comme axe horizontal, mais une grandeur appelée "résistance à la diffusion de vapeur" (\(S_{\text{d}}\)). L'avantage est que, sur cet axe, le profil de la pression de vapeur réelle (\(P_{\text{v}}\)) devient une simple ligne droite entre le point intérieur et le point extérieur, ce qui simplifie énormément le tracé et l'analyse.
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
La construction correcte de l'axe des abscisses (\(S_{\text{d}}\)) est l'étape la plus importante. Chaque matériau a sa propre résistance à la diffusion. Il faut les calculer une par une, puis les cumuler pour positionner correctement chaque interface sur le graphique. Une erreur sur l'axe des \(S_{\text{d}}\) faussera toute l'interprétation du diagramme.
Normes (la référence réglementaire)
La méthode graphique du diagramme de Glaser est la procédure de vérification standard décrite dans la norme ISO 13788 pour l'analyse manuelle du risque de condensation interstitielle en régime stationnaire. Les logiciels de calcul thermique automatisent cette méthode.
Formule(s) (l'outil mathématique)
Résistance à la diffusion de vapeur
Interpolation de la pression de vapeur
Hypothèses (le cadre du calcul)
La principale hypothèse de cette méthode est que le flux de vapeur est en régime stationnaire et que le profil de pression de vapeur est linéaire par rapport à la résistance à la diffusion \(S_{\text{d}}\). On néglige également les résistances superficielles à la diffusion de vapeur, qui sont très faibles par rapport à celles des matériaux.
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Pression de vapeur intérieure | \(P_{v,i}\) | 1520 | Pa |
| Pression de vapeur extérieure | \(P_{v,e}\) | 338 | Pa |
| Pression de saturation interface 1 | \(P_{sat,1}\) | 2176 | Pa |
| Pression de saturation interface 2 | \(P_{sat,2}\) | 1918 | Pa |
| Pression de saturation interface 3 | \(P_{sat,3}\) | 432 | Pa |
| \(\mu \cdot e\) (Plâtre) | - | \(10 \cdot 0.015\) | m |
| \(\mu \cdot e\) (Brique) | - | \(15 \cdot 0.20\) | m |
| \(\mu \cdot e\) (Isolant) | - | \(1.2 \cdot 0.12\) | m |
| \(\mu \cdot e\) (Enduit) | - | \(25 \cdot 0.02\) | m |
Schéma (Avant les calculs)
On prépare le canevas du diagramme de Glaser, avec l'axe des pressions en ordonnée et l'axe des résistances à la diffusion en abscisse, sur lequel on positionne les couches du mur.
Canevas du Diagramme de Glaser
Calcul(s) (l'application numérique)
Étape 1 : Calcul des résistances à la diffusion (\(S_{\text{d}}\)) et de leurs cumuls
| Élément | Calcul de \(S_{\text{d}} \text{ (m)}\) | Valeur \(S_{\text{d}}\) | \(S_{\text{d}}\) cumulée |
|---|---|---|---|
| Plâtre | \(10 \cdot 0.015\) | 0.150 | 0.150 |
| Brique | \(15 \cdot 0.20\) | 3.000 | 3.150 |
| Isolant | \(1.2 \cdot 0.12\) | 0.144 | 3.294 |
| Enduit | \(25 \cdot 0.02\) | 0.500 | 3.794 (\(S_{\text{d,total}}\)) |
Étape 2 : Synthèse des points pour le diagramme
On regroupe toutes les informations dans un tableau final. La colonne \(P_{\text{v}}\) est calculée par interpolation. Par exemple, pour l'interface 2 :
| Point | \(S_{\text{d}}\) cumulée (m) | \(P_{\text{v}}\) (Pa) | \(P_{\text{sat}}\) (Pa) |
|---|---|---|---|
| Intérieur | 0 | 1520 | 2339 |
| Interface 1 (Plâtre/Brique) | 0.150 | 1473 | 2176 |
| Interface 2 (Brique/Isolant) | 3.150 | 539 | 1918 |
| Interface 3 (Isolant/Enduit) | 3.294 | 494 | 432 |
| Extérieur | 3.794 | 338 | 422 |
Schéma (Après les calculs)
Le tracé final est obtenu en reportant les points du tableau sur un graphique. Le diagramme ci-dessous représente le résultat final de nos calculs et montre clairement le croisement des deux courbes.
Réflexions (l'interprétation du résultat)
La construction de ce tableau de points est l'aboutissement de tout notre travail. Nous avons maintenant deux séries de points (\(P_{\text{v}}\) et \(P_{\text{sat}}\)) à positionner le long de l'axe \(S_{\text{d}}\). La courbe \(P_{\text{v}}\) sera une droite parfaite, tandis que la courbe \(P_{\text{sat}}\) suivra une allure dictée par le profil de température, chutant fortement au niveau de l'isolant.
Points de vigilance (les erreurs à éviter)
Attention à bien utiliser les valeurs de \(S_{\text{d}}\) cumulées pour l'axe des abscisses. Une erreur fréquente est de positionner les interfaces en utilisant les valeurs de \(S_{\text{d}}\) individuelles de chaque couche, ce qui est incorrect et fausse complètement le diagramme.
Points à retenir (pour maîtriser la question)
Pour construire le diagramme de Glaser :
- L'axe des abscisses (X) est la résistance à la diffusion de vapeur cumulée (\(S_{\text{d}}\)).
- L'axe des ordonnées (Y) est la pression de vapeur (en Pa).
- On y trace deux courbes : \(P_{\text{v}}\) (droite) et \(P_{\text{sat}}\) (courbe).
Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)
La méthode de Glaser est une méthode statique, valable pour des conditions stables. Pour des analyses plus poussées (impact de la pluie, du soleil, cycles saisonniers), les ingénieurs utilisent des logiciels de simulation hygrothermique dynamique comme WUFI®. Ces outils simulent les transferts de chaleur et d'humidité heure par heure sur plusieurs années, offrant une vision beaucoup plus réaliste du comportement du mur.
FAQ (pour lever les doutes)
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour vérifier la compréhension)
Si on remplaçait la brique par un béton de 20 cm ayant un \(\mu=80\), quelle serait la nouvelle valeur de \(S_{\text{d}}\) cumulée à l'interface 2 (Béton/Isolant) ?
Question 6 : Analyser le diagramme et le risque de condensation
Principe
L'analyse du risque de condensation consiste à comparer, en tout point de la paroi, la pression de vapeur réelle (\(P_{\text{v}}\)) à la pression de vapeur saturante (\(P_{\text{sat}}\)). Si, à un endroit, la pression réelle dépasse la pression maximale que l'air peut supporter à cette température (\(P_{\text{v}} > P_{\text{sat}}\)), alors il y a condensation.
Analyse du diagramme
En observant les données du tableau (ou le graphique), on constate qu'à l'interface 3 (entre l'isolant et l'enduit extérieur), la situation est la suivante :
- Pression de vapeur réelle : \(P_{\text{v}} = 494\) Pa
- Pression de vapeur saturante : \(P_{\text{sat}} = 432\) Pa
Nous avons \(P_{\text{v}} > P_{\text{sat}}\). Graphiquement, cela signifie que la droite représentant la pression de vapeur réelle passe au-dessus de la courbe de pression de vapeur saturante.
Points de vigilance
Conclusion : Le croisement des courbes confirme qu'il y a condensation. Le phénomène se produit dans la partie la plus froide de la paroi, juste avant la couche qui freine le plus la sortie de la vapeur. Ici, l'enduit extérieur (\(\mu=25\)) est peu perméable et "bloque" la vapeur dans l'isolant, qui est à une température négative. C'est un cas d'école de condensation interstitielle due à un "pare-vapeur" mal placé (côté froid).
Résultat Final
Outil Interactif : Simulateur de Point de Rosée
Utilisez les curseurs pour faire varier la température extérieure et l'humidité relative intérieure. Observez comment le profil de pression de vapeur saturante change et si un risque de condensation apparaît (lorsque la courbe bleue passe sous la courbe rouge).
Paramètres d'Entrée
Résultats Clés
Quiz Final : Testez vos connaissances
1. Si la température de l'air augmente sans ajout de vapeur d'eau, que devient son humidité relative ?
2. Lequel de ces matériaux est le plus résistant à la diffusion de la vapeur d'eau ?
3. Dans le diagramme de Glaser, une condensation se produit lorsque...
- Point de rosée
- Température à laquelle l'air, à pression et humidité constantes, doit être refroidi pour que la vapeur d'eau qu'il contient commence à se condenser sous forme liquide.
- Pression de vapeur saturante (\(P_{\text{sat}}\))
- Pression maximale que la vapeur d'eau peut exercer à une température donnée. C'est la limite avant la condensation.
- Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (\(\mu\))
- Coefficient sans dimension qui indique combien de fois un matériau est moins perméable à la vapeur d'eau que l'air stagnant.
- Diagramme de Glaser
- Outil graphique qui permet de visualiser les profils de pression de vapeur et de pression de vapeur saturante à travers une paroi pour identifier les risques de condensation.
D’autres exercices de thermiques des batiments:





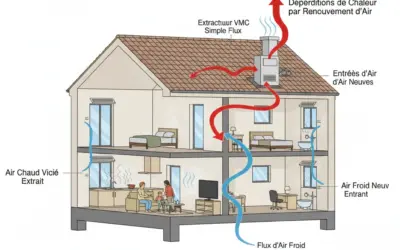
0 commentaires